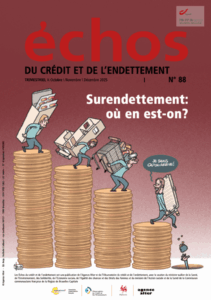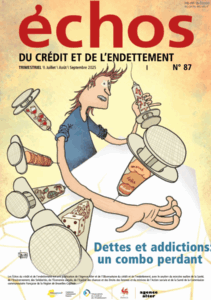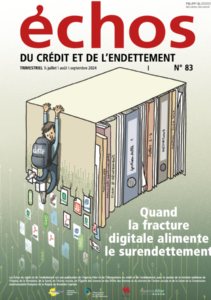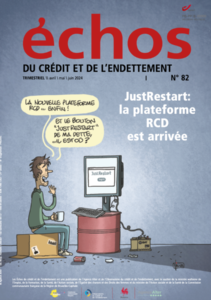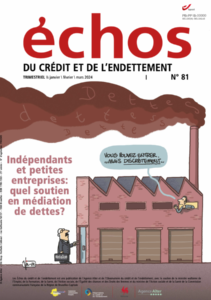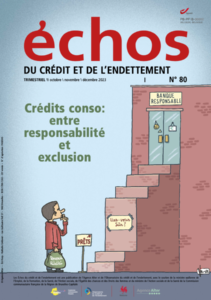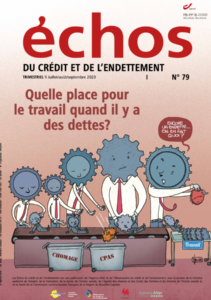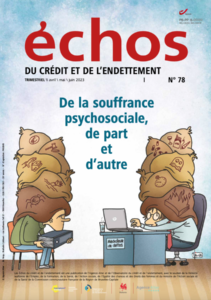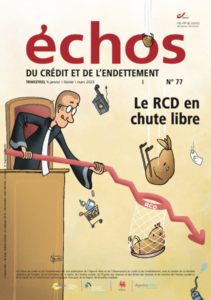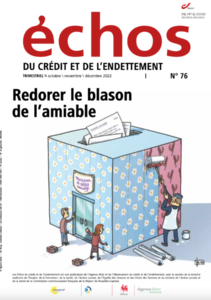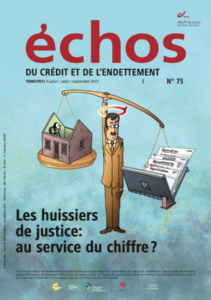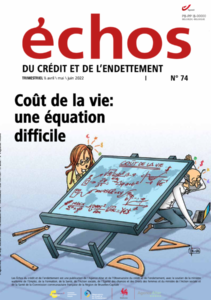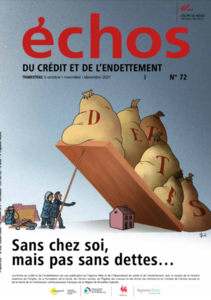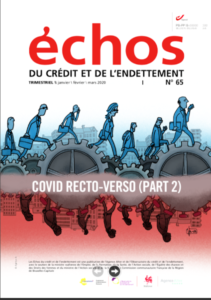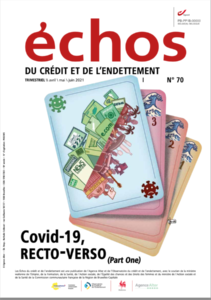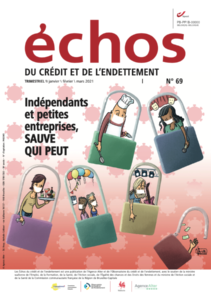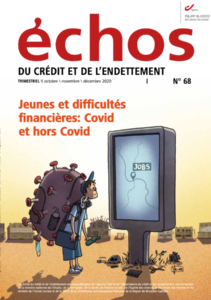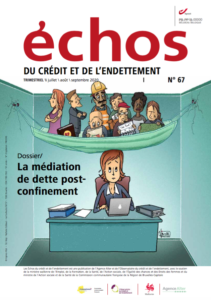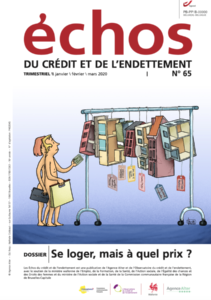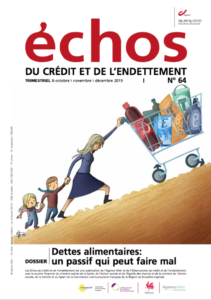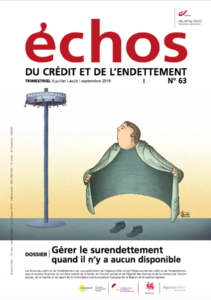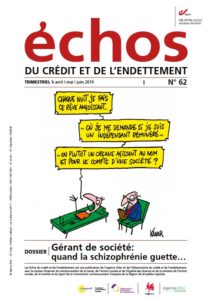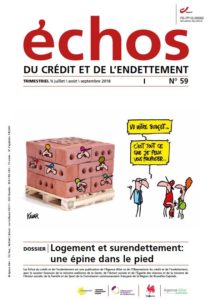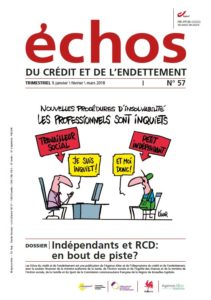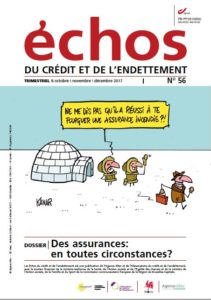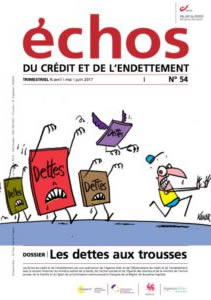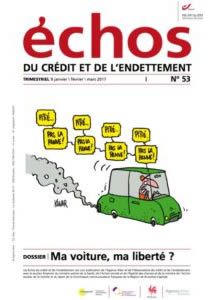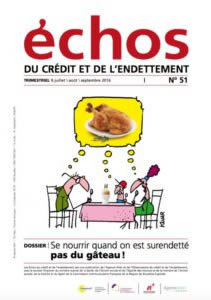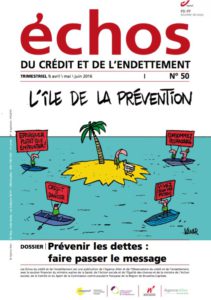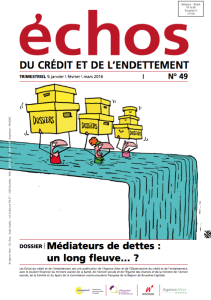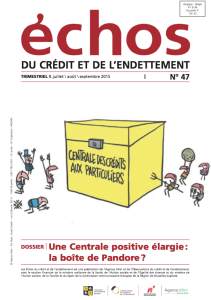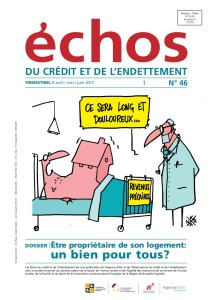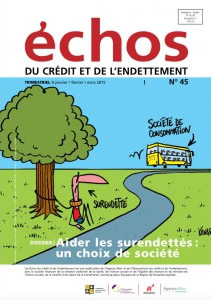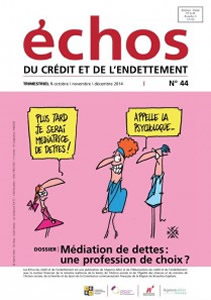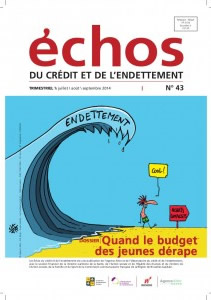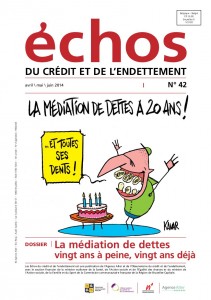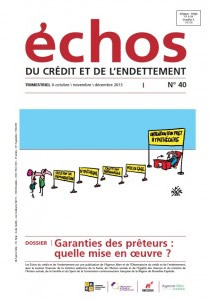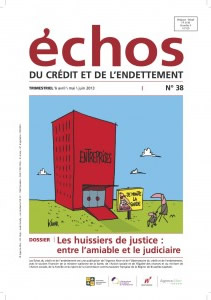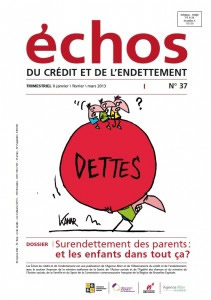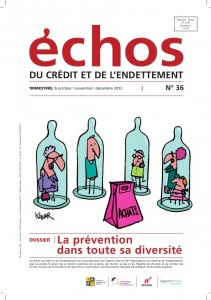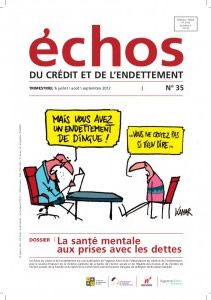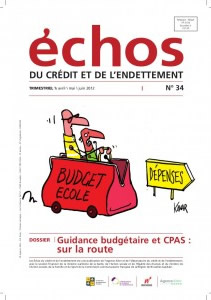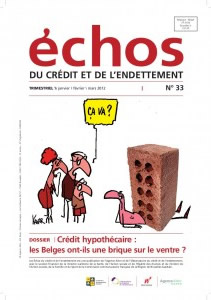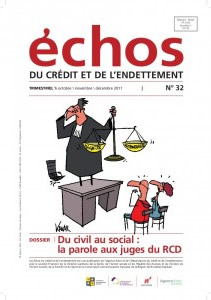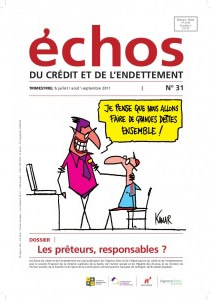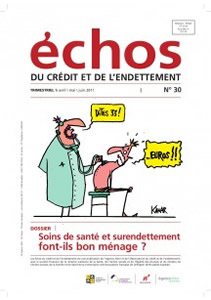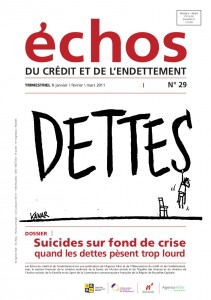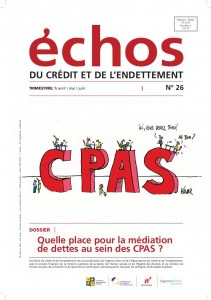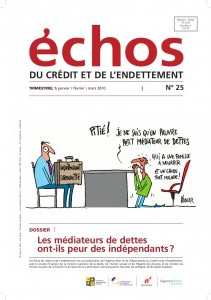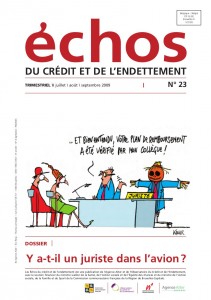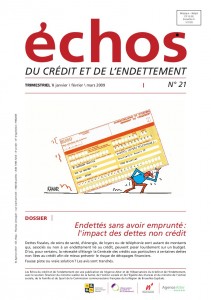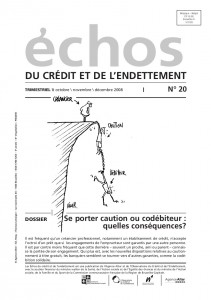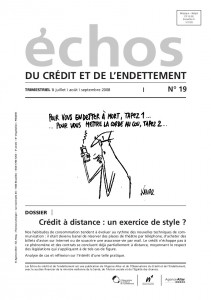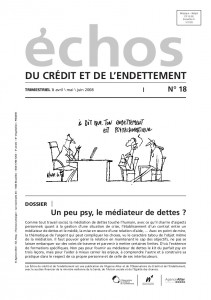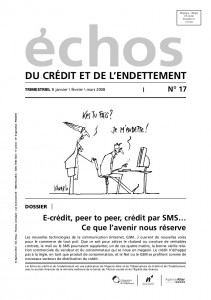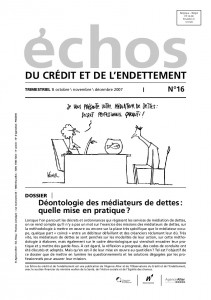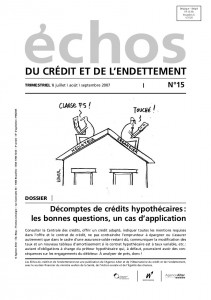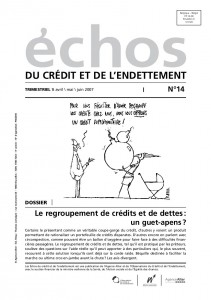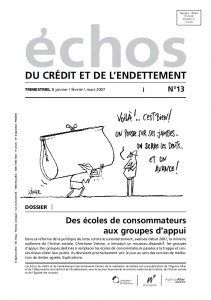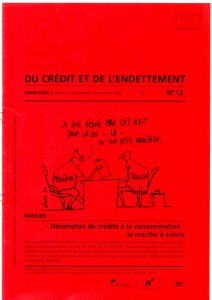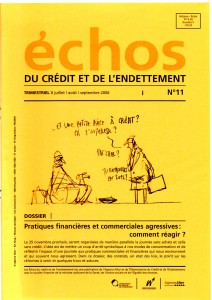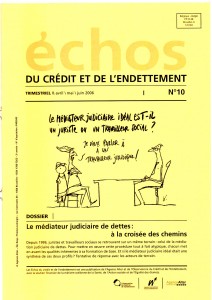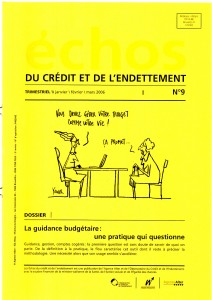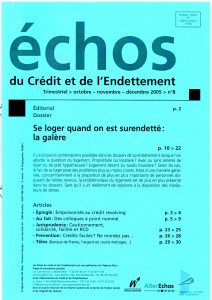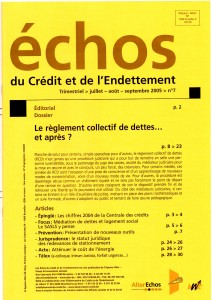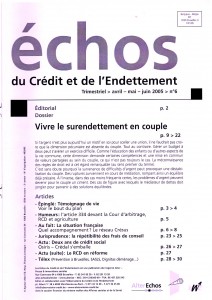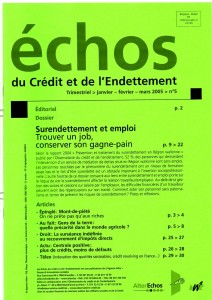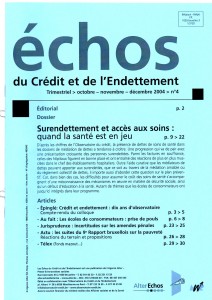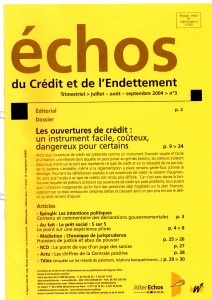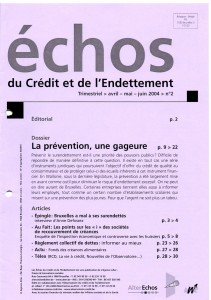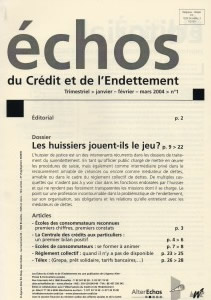Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait, une fois n’est pas coutume, au crédit à la consommation. Nous les avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées grâce au concours du SPF Économie. En voici la recension.
J.P. Neufchâteau, 19 septembre 2024 (RG 21A1013)
But du crédit – Panneaux photovoltaïques – Libération des sommes empruntées – Absence de livraison –Remboursement des montants payés.
Le 5 juin 2012, l’emprunteur a conclu deux contrats de vente pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Le paiement de l’intégralité de la facture devait être fait dans les huit jours de la signature. Ce paiement avait «valeur de confirmation pour la commande, la fabrication et la date d’installation […]».
Le courtier de crédit a négocié un prêt à tempérament avec la banque. L’emprunteur l’a signé le 14 juin 2012. Son compte est crédité le 25 juin 2012. Il a payé la facture le 3 juillet 2012. Celle-ci ne mentionnait aucun planning pour la réalisation de l’installation. La société n’a procédé ni à la livraison ni à l’installation des panneaux. L’emprunteur et d’autres consommateurs lésés ont déposé une plainte contre cette société. Celle-ci est déclarée en faillite le 4 mars 2013.
Le 15 février 2017, le conseil de l’emprunteur a mis la banque en demeure de rembourser les mensualités déjà payées en invoquant l’article 19 de la loi sur le crédit à la consommation[1] qui prévoit notamment que, «lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l’identité du vendeur ou du prestataire de services n’est pas connue par le prêteur».
La banque a refusé en argumentant que l’article 19 n’était pas d’application, que le but du crédit n’était pas mentionné dans le contrat et qu’elle ne connaissait pas les conditions de livraison, car elle n’avait pas connaissance des contrats.
Par jugement du 21 février 2019, le juge de paix d’Andenne donne raison à l’emprunteur. Il condamne la banque au remboursement des mensualités déjà payées. La banque interjette appel. Le 6 septembre 2021, le tribunal de première instance de Namur réforme le jugement et renvoie la cause devant la justice de paix de Neufchâteau.
Le juge analyse l’article 19 de la loi sur le crédit à la consommation:
- Le but de cette disposition est «d’édicter des règles protectrices pour le consommateur lorsque ce dernier contracte un crédit qui sert à financer un contrat de vente ou de prestation de services, et ce en subordonnant l’exécution du contrat de crédit à l’exécution du contrat de vente ou de prestation de services»[2].
- Pour la Cour de cassation[3], «le contrat de crédit doit mentionner le bien ou la prestation de service financé […] Le régime de suspension prévu par l’article 19 précité s’applique dès que le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé, sauf si le montant du crédit est remis au consommateur et que l’identité du vendeur ou du prestataire de services n’est pas connue du prêteur, soit le montant du crédit est versé directement par le prêteur au vendeur. Il s’agit du seul lien requis, au sens de cette disposition, entre le contrat de crédit et le contrat de vente ou de fourniture. Il ne s’ensuit dès lors pas que le consommateur, à qui le montant du crédit est remis, ne puisse invoquer la suspension de l’exécution de ses obligations envers le prêteur que lorsque le contrat de vente ou de fourniture prévoit que le prix doit être payé, non lors de la conclusion de ce contrat, mais au moment de la livraison du bien ou du service. L’exécution de l’obligation du consommateur de rembourser le crédit est suspendue, non tant que le prix du bien ou du service n’est pas payé au vendeur ou au fournisseur, mais tant que le bien n’a pas été livré ou le service fourni par ces derniers. D’autre part, en vertu de l’article 1168 de l’ancien Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive. Suivant l’article 1185 du même code, le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement dont il retarde seulement l’exécution. La livraison du bien ou la fourniture du service constitue un événement futur et incertain dès lors que sa réalisation dépend du vendeur ou du fournisseur, tiers ou contrat de crédit. Il s’ensuit que l’obligation du consommateur de rembourser le prêteur est soumise, non à un terme, mais à la condition suspensive de la livraison du bien ou de la fourniture du service».
Dans son commentaire[4], Christine Biquet-Mathieu précise que, «concernant le champ d’application de la protection, la Cour de cassation précise encore qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que le contrat portant sur la livraison du bien financé prévoit un paiement à la livraison ou un paiement immédiat avant toute livraison. Ainsi, si le prêteur remet le montant du crédit au consommateur avant la livraison du bien financé, mentionné dans le contrat de crédit, le consommateur, qui a utilisé le crédit pour payer le fournisseur avant la livraison, conserve la protection de l’article 19 (devenu article VII.91). Ses obligations de rembourser le crédit et de supporter les intérêts ne prennent pas effet avant la livraison. Pour le dire autrement, le prêteur qui verse, de façon prématurée, le montant du crédit au consommateur doit assumer la fragilité de sa position, à savoir qu’avant la livraison du bien financé, il n’a le droit d’exiger aucun intérêt ni remboursement».
En l’espèce, le but du crédit mentionné était «Energy@Home». L’objet est donc clair, à savoir profiter d’énergie à la maison. De plus, les échanges entre l’intermédiaire de crédit et la banque mentionnent que «le but du crédit est l’achat de panneaux photovoltaïques». La banque savait également, à la libération des fonds, que l’installation des panneaux n’avait pas encore eu lieu (contrats signés le 5 juin 2012, facture du 19 juin 2012, prêt contracté le 14 juin 2012 et libéralisation des fonds le 25 juin 2012).
Le juge considère l’action fondée et condamne la banque au remboursement des mensualités payées[5] à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à dater de chacune des mensualités jusqu’au paiement complet.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
J.P. Fléron, 23 mai 2024 (RG 23A395)
Conclusion d’un contrat de crédit – Validité du consentement – Responsabilité du prêteur.
Madame a contracté un prêt pour l’achat d’un nouveau véhicule. En défaut de paiement, le prêteur a dénoncé le crédit et a notifié son intention de mettre en œuvre la cession de rémunération. Madame a fait opposition et a négocié des plans de paiement qu’elle n’a pas respectés.
Elle invoque la nullité du contrat. Souffrant d’addiction, elle estime que, lors de la signature, elle n’était pas en état de donner valablement son consentement. Elle fournit des documents médicaux qui attestent de son alcoolisme depuis 2005.
On ne peut pas considérer que cette addiction la rendait incapable de gérer ses biens et de signer valablement le contrat. Personne, même pas son médecin traitant, n’a jugé judicieux de demander une mesure d’administration de biens.
Elle invoque aussi un comportement fautif dans le chef du prêteur. Selon elle, il aurait dû refuser le crédit, car elle bénéficiait d’une pension de 1.158 €, était dans un «état second» lors de la signature et le véhicule acheté était trop volumineux pour elle.
Le prêteur doit évaluer la capacité de remboursement de l’emprunteur. En pratique, le prêteur considère que la charge de crédit ne peut pas dépasser le tiers des revenus. En l’occurrence, c’est le cas.
Rien ne permet de démontrer l’état second de Madame.
Le prêteur doit également vérifier la légalité du but du crédit, pas apprécier son opportunité.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur.
Le juge condamne Madame au remboursement du solde du crédit à majorer des intérêts moratoires et valide la cession de rémunération.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
CJU.E. (10e ch.), 13 février 2025 (C-472/23)[6]
Contrat de crédit – Directive 2008/48/CE – Mentions obligatoires – Devoirs du prêteur – Obligation d’information – TAEG – Clauses abusives – Conditions d’adaptation des coûts – Sanction proportionnée.
Le tribunal d’arrondissement de Varsovie a été saisi par un avocat, cessionnaire des droits d’un consommateur. Il réclame le remboursement d’une partie des intérêts et des frais payés par l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation. Il invoque la violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive 2008/48. Cette directive impose notamment aux États membres de mentionner dans le contrat de crédit le TAEG[7] et les conditions d’adaptation des coûts[8]. Elle prévoit également une sanction en cas de non-respect de ces obligations par le prêteur[9].
Le tribunal pose trois questions préjudicielles à la Cour.
1°) Le prêteur a-t-il respecté son devoir d’information lorsqu’un contrat de crédit mentionne un TAEG trop élevé en raison de clauses ensuite reconnues comme abusives?
Le TAEG représente le coût total du crédit, c’est-à-dire «tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus du prêteur à l’exception des frais de notaire […]»[10]. Cette mention obligatoire permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement financier. La mention d’un TAEG erroné, surévalué ou sous-estimé, ne permet pas d’atteindre cet objectif.
En l’espèce, les intérêts ont été calculés sur le montant du crédit et sur les coûts y afférents. De ce fait, le TAEG mentionné dans le contrat est trop élevé. La Cour estime que cette clause est abusive et qu’elle ne lie donc pas le consommateur.
La Cour souligne que le TAEG a été calculé selon la directive: «Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions ainsi que dans les délais précisés dans ce contrat»[11] et conformément à la formule mathématique se basant sur «les coûts que le consommateur est tenu de payer en application des clauses de ce contrat, y compris celles qui, par la suite, s’avèrent abusives et ne lient pas le consommateur.»
La Cour considère qu’il n’y a pas de violation de l’obligation d’information, même si celui-ci est surestimé.
2°) Le prêteur a-t-il respecté son devoir d’information lorsque le contrat énumère des conditions susceptibles d’augmenter les frais sans que le consommateur puisse vérifier leur survenance et leur incidence?
Cette mention est nécessaire à la bonne compréhension du consommateur de ses droits et de ses obligations, à l’exercice de ses droits et à la bonne exécution du contrat. Pour atteindre ces objectifs, l’information relative aux motifs et modes de variation des frais doit être transparente et dénuée d’imprécision objective, de sorte qu’un «consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» puisse prévoir les modifications éventuelles des frais.
En l’espèce, le contrat prévoit des indicateurs difficilement vérifiables, variables, parfois contrôlés par la banque elle-même, décrits en termes vagues… et limite les augmentations des frais quantitativement (maximum 200%) et temporairement (quatre fois par an au maximum et au plus tard six mois après la survenance de la condition).
Le consommateur ne peut donc pas apprécier correctement la portée de son engagement.
La Cour retient une violation de l’obligation d’information.
3°) La sanction en cas de violation de l’obligation d’information est-elle conforme à la directive?
La directive prévoit que chaque État membre définisse la sanction applicable en cas de violation des obligations précitées ainsi que les mesures nécessaires pour les appliquer. De plus, ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives[12].
En l’occurrence, le droit polonais prévoit de «déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, indépendamment du niveau de gravité de la violation et de son incidence sur la décision du consommateur de conclure le contrat de crédit».
La Cour considère qu’une telle sanction est proportionnée si l’obligation violée revêt une importance essentielle, de sorte que l’absence ou l’erreur dans la mention empêche au consommateur d’apprécier la portée de son engagement. Selon la Cour, tel est le cas des mentions dont il est question. La sanction prévue n’est pas disproportionnée.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
J.P. Marche-en-Famenne, 20 février 2024 (RG 22A611)
Ouvertures de crédit – Affectation hypothécaire – Cessions de rémunération – Actes distincts – Validation des cessions.
La banque a consenti à l’emprunteuse deux ouvertures de crédit. Celles-ci sont garanties par une affectation hypothécaire. De plus, chaque acte d’ouverture contient une clause qui prévoit une cession de rémunération et de créances.
Face aux défauts de paiement de ces deux ouvertures de crédit, la banque a notifié à l’emprunteuse son intention d’exécuter les deux cessions de rémunération. L’emprunteuse s’y est opposée le 24 mai 2025. La banque demande donc au juge de paix de valider ces deux cessions de rémunération.
Dans un premier jugement rendu le 4 octobre 2022, le juge demande à la banque de produire les contrats d’ouverture de crédit et les deux actes de cession de rémunération séparés.
Pour rappel, une cession de rémunération prend la forme d’un contrat par lequel le débiteur
(= l’emprunteuse) autorise son débiteur de revenus (= son employeur) à remettre une partie de sa rémunération[13] au créancier (= la banque). Elle doit faire l’objet d’un acte distinct, établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct[14].
La banque a déposé son dossier de pièces. Il contient les actes notariés relatifs aux deux ouvertures de crédit, les conditions générales et particulières de la banque et les actes de cession de rémunération.
Après plusieurs réouvertures des débats, le juge constate, le 20 février 2024, que le formalisme lié à la cession de rémunération a bien été respecté. Il décide donc de valider les deux cessions de rémunération.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
J.P. Binche, 16 mai 2024 (RG 24A251).
Facilités de paiement – Procédure – Conditions – Pouvoir d’appréciation du juge.
L’emprunteuse a souscrit, en septembre 2022, un prêt à tempérament. Celui-ci avait pour but de solder d’autres crédits en cours. Depuis qu’elle est pensionnée, elle éprouve des difficultés à respecter ses remboursements.
Pour rappel, le consommateur qui a des difficultés pour rembourser son ou ses crédits peut demander des facilités de paiement[15]. Elles permettent de rééchelonner les paiements à effectuer et, le cas échéant, à allonger le délai de remboursement. Pour obtenir ces facilités de paiement, le consommateur doit prouver que sa situation financière s’est détériorée depuis l’octroi du prêt.
Le consommateur doit d’abord adresser une lettre recommandée au prêteur pour solliciter ces facilités de paiement. Si celui-ci refuse ou ne réagit pas dans le mois, le consommateur peut introduire une procédure devant le juge de paix[16].
En l’espèce, l’emprunteuse a bien demandé à son créancier des facilités de paiement. Celui-ci a refusé, par courriel du 12 janvier 2024, de les lui accorder. L’emprunteuse a donc introduit une requête le 16 février 2024. De plus, comme le justifie le caractère préventif de cette mesure, l’emprunteuse atteste que le juge n’a pas été saisi d’une autre demande[17].
Par courrier recommandé du 17 février 2024, le prêteur dénonce le prêt à tempérament. Cependant, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme ou de la clause résolutoire expresse n’empêche pas le juge d’accorder des facilités de paiement[18].
Le juge de paix dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’octroi des facilités de paiement demandées. Son appréciation ne porte pas sur les circonstances qui ont engendré cette situation, mais sur l’aggravation objective de la situation financière du consommateur.
Depuis qu’elle est pensionnée (en juillet 2023), les revenus mensuels de l’emprunteuse ont diminué, de l’ordre de plus ou moins 450 euros net par mois. Avec l’aide d’un centre public d’action sociale, elle a établi un relevé de sa situation financière. Il en ressort que ce crédit ne pourra être remboursé sans facilités de paiement.
Mais attention, les mensualités proposées doivent au minimum payer les intérêts dus périodiquement. En l’occurrence, elles permettent de rembourser les intérêts et une partie du capital.
Le juge décide donc d’accorder les facilités de paiement proposées.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Maëlle Servais et Christelle Wauthier, juristes à l’Observatoire du crédit et de l’endettement
[1] Art. VII.91 CDE actuel.
[2] M. Englebert, «La crise du secteur des panneaux photovoltaïques: quelles conséquences pour les prêteurs et les emprunteurs?», J.L.M.B., 2018/2, p. 82.
[3] Cass., 6 mai 2022 (n°C.21.0140.F).
[4] Note sous Cass., 6 mai 2022 (n°C.21.0140.F) «Financement d’un bien, jamais livré, par un crédit à la consommation et paiement indu», J.J.P. 2022, p. 591.
[5] L’emprunteur a payé jusqu’en janvier 2019.
[6] Voir «Obligation d’information du prêteur et transparence des clauses dans un contrat de crédit à la consommation», D. Blommaert et Pr. Algrain (https://observatoire-credit.be/fr/juriobs/587/obligation-dinformation-du-preteur-et-transparence-des-clauses-dans-un-contrat-de-credit-a-la-consommation).
[7] Art. 10, § 2, g de la directive 2008/48/CE.
[8] Art. 10, § 3, k de la directive précitée.
[9] Art. 23 de la directive précitée.
[10] Art. 3, g et i, de la directive précitée.
[11] Art. 19, § 3 de la directive précitée.
[12] Art. 23 de la directive précitée.
[13] Pour calculer les quotités cessibles et insaisissables, https://observatoire-credit.be/fr/boite-a-outils.
[14] Article 5.183 C. civ.; loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération (M.B. 30.04.1965, p. 4710).
[15] Art. VII.107, §1er, CDE.
[16] Art. 1337bis, CJ.
[17] Art. 1337ter, § 2, CJ.
[18] Art. VII.107, §1er CDE.