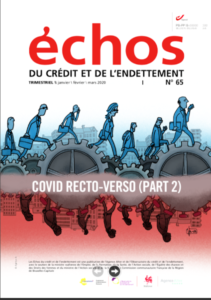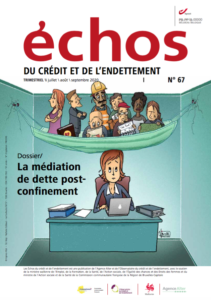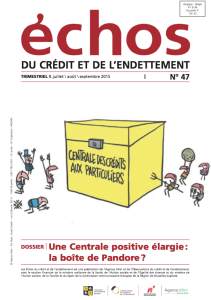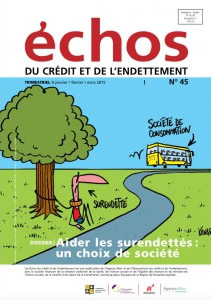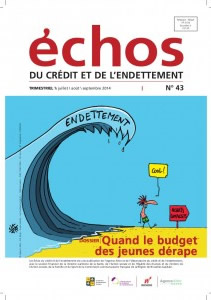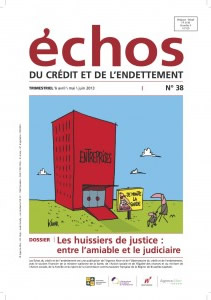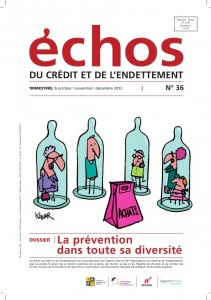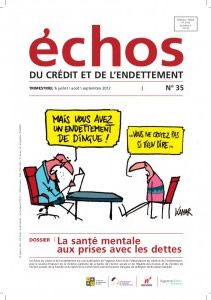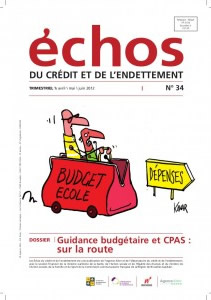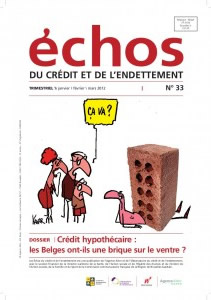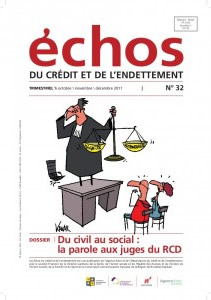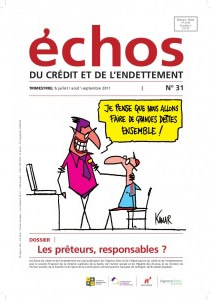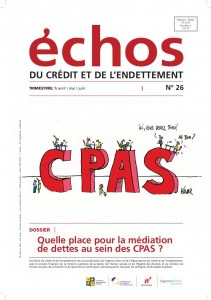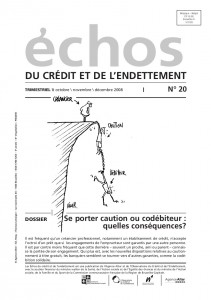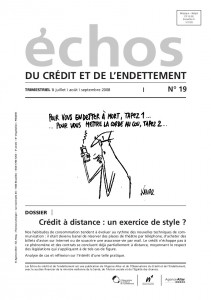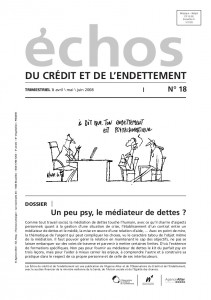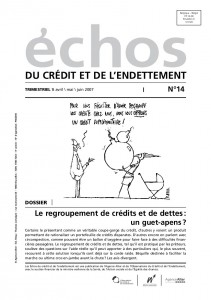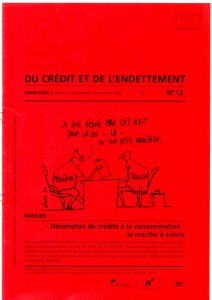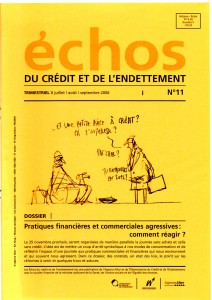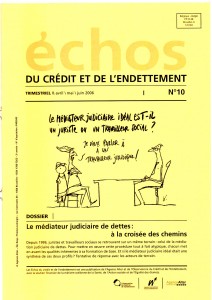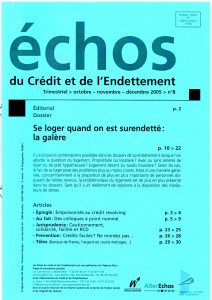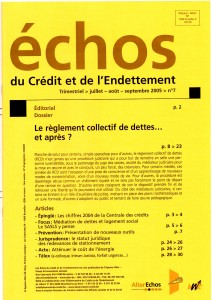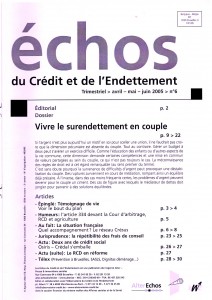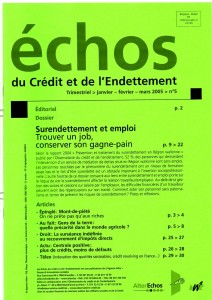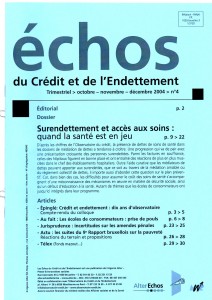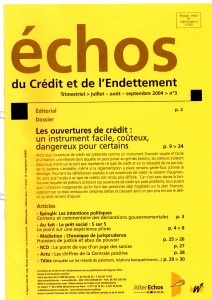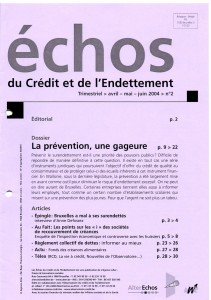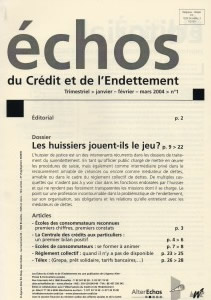Cela fait des années que l’on parle de la charge de plus en plus lourde de travail gérée par les travailleurs sociaux, avec de la souffrance, du stress, l’impression d’être noyés, voire broyés. Avec le Covid et les différentes crises (énergétiques, des prix à la consommation, la guerre en Ukraine), cette impression est plus vive encore et se concrétise par de la souffrance au travail, du surmenage et des burn-out. La charge psychosociale devrait être prise en compte par les employeurs, mais c’est sans doute tout un système qui est à repenser.
Tout d’abord quelques chiffres pour situer l’ampleur des dégâts. D’après les chiffres de l’INAMI, fin 2020, le nombre de travailleurs en invalidité (soit depuis plus d’un an en arrêt maladie) avoisinait le chiffre de 500.000 personnes, soit une augmentation de 20% en quatre ans, avec parmi eux, 36,8% des malades de longue durée liés à des problèmes de santé mentale. Parmi eux, 33.402 personnes souffrant de burn-out (soit 33,09% de plus qu’en 2016) et 78.330 malades de longue durée souffrant de dépression (avec une hausse de 42,92% entre 2016 et 2020).
Toujours en Belgique, les résultats de l’enquête «Power to Care» menée par Sciensano sur le bien-être des personnes et des professionnels de l’aide et des soins ont été publiés en juin 2021[1]. 951 professionnels y ont participé et il ressort de cette enquête que, sur le plan personnel, 54% des sondés éprouvent un sentiment de fatigue fort à très fort. 45% des répondants estiment être sous pression et 39% n’arrivent pas à se détendre suffisamment. 31% d’entre eux éprouvent des problèmes de concentration, 28%, des symptômes d’hypervigilance et 14% un sentiment d’anxiété. Le manque de sommeil est présent pour 36% des participants à l’enquête. Quant aux plaintes physiques, elles concernent les douleurs musculaires et articulaires (32%), des maux de tête (29%) des problèmes d’estomac (17%), des problèmes de peau (14,5%), des palpitations (11,2%).
Sur le plan professionnel, la pandémie a également laissé des traces: 22% des personnes interrogées déclaraient envisager de quitter leur profession (contre 10% avant la pandémie); 20% se sentent isolés et seulement 53% ont déclaré avoir le sentiment de faire partie d’une équipe. À peine un tiers imagine pouvoir demander du soutien et de l’accompagnement. L’enquête révèle donc qu’un grand groupe de personnes travaillant dans le social et le soin continue de ressentir les effets du stress chronique, avec des effets négatifs sur leur bien-être et un risque accru de désengagement.
Quid du bien-être au travail?
Pourtant, selon le Code du bien-être au travail, qui reprend tous les arrêtés d’exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, tout employeur est obligé de mener une politique dans son entreprise pour promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Ce Code est un instrument qui rassemble toutes les dispositions réglementaires pertinentes à la mise en œuvre de cette politique. Les lois du 28 février 2014 et celle du 20 mars ont modifié la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail et le Code judiciaire pour y introduire les éléments de réglementation relatifs aux risques psychosociaux. Concernant les risques psychosociaux (RPS) liés au travail, ceux-ci recouvrent des risques professionnels qui portent aussi bien atteinte à la santé mentale que physique des travailleurs et qui ont un impact sur le bon fonctionnement des entreprises ainsi que sur la sécurité. Parmi les manifestations les plus connues, on peut citer le stress, le harcèlement moral, le burn-out, la charge mentale cognitive ou émotionnelle, les conflits liés au travail, la pression psychologique, mais aussi l’abus d’alcool ou de drogues.
Cette réglementation s’appuie sur le principe d’une analyse des risques à propos de la santé, la sécurité, l’ergonomie, l’hygiène au travail, ainsi que les aspects psychosociaux. L’analyse des risques se passe sur trois niveaux: l’organisation dans son ensemble; chaque groupe de postes de travail ou de fonctions; l’individu lui-même. Cette analyse se compose de trois phases: l’identification des dangers, la définition et la détermination des risques et leur évaluation. Elle permet ensuite de développer des mesures de prévention appropriées pour éliminer les dangers, prévenir et limiter les dommages. Les acteurs de la prévention (l’employeur, la ligne hiérarchique, les travailleurs) se font aider par des spécialistes, appelés conseillers en prévention. Ceux-ci assistent les employeurs dans l’application des dispositions sur le bien-être. Il peut aussi être fait appel à un service externe de prévention et de protection au travail agréé.
Pour plus d’infos: voir le Guide pour la prévention des risques psychosociaux au travail, téléchargeable: https://bit.ly/3mC02C7
Concrètement, le bien-être des travailleurs dans le cadre professionnel n’est pas forcément un objectif atteint. Marine Keresztes, chercheuse au Centre permanent pour la citoyenneté et la participation, cite l’étude internationale «State of a global workplace»[2] datant de 2017 et menée par l’institut Gallup sur la qualité de vie au travail et l’engagement des salariés. Cette étude signale que, «parmi les travailleurs actifs sur la planète, 15% des personnes qui travaillent se disent engagées et sont heureuses à l’idée d’aller travailler. Elles sont hautement impliquées et enthousiastes vis-à-vis de leur travail et de leur lieu de travail. 67% sont des salariés désengagés: ces personnes ne ressentent pas d’attachement à leur travail ni à l’entreprise. […] Enfin, 18% sont des employés activement désengagés. Ils sont malheureux au travail et en veulent à l’entreprise de ne pas satisfaire leurs besoins. Ils font connaître leur mécontentement et peuvent potentiellement saboter le travail accompli par leurs collègues engagés»[3].
À l’échelle de la Belgique francophone, Laurent Lorthioir rend également compte dans un article de la revue Démocratie[4] de l’évaluation des politiques RPS, sur la base d’une enquête réalisée par la CSC auprès des conseillers en prévention. Les témoignages montrent que, lorsqu’un problème est pointé, il est souvent ignoré. La politique de prévention primaire telle qu’elle devrait être mise en place est souvent absente ou est appliquée de manière partielle et incorrecte. Les analyses sont trop souvent opaques et insuffisamment prises en compte dans la politique de prévention. Les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ont tendance à se focaliser sur les questions de qualité et de sécurité au travail.
Tout porte à croire que les chiffres en matière de RPS n’ont guère évolué dans le bon sens depuis la pandémie du Covid: selon la septième réunion de l’Institut syndical européen (ETUI – European Trade Union Institute) sur les risques psychosociaux au travail, la pandémie a mis en évidence les inégalités et a aggravé les risques existants, rendant ainsi le phénomène encore plus critique. Tous les pays de l’OCDE ont vu la santé mentale des travailleurs se détériorer en 2020. Les résultats physiques et psychologiques observés comprennent le burn-out, l’anxiété, la dépression, l’insomnie, la fatigue ou encore les symptômes de stress post-traumatique[5]. ETUI relève également que les travailleurs précaires sont particulièrement fragilisés, tout comme les femmes sont particulièrement touchées par la violence économique. Le corps enseignant a également beaucoup souffert, ainsi que les travailleurs des secteurs de la santé et de l’aide sociale qui font partie des groupes professionnels les plus exposés aux RPS.
On parle aussi de vulnérabilité dans le chef des travailleurs sociaux. Didier Vrancken, dans un article dans la revue Penséeplurielle n°30-31, évoque cette vulnérabilité autour de trois éléments: «En premier lieu, le regard critique de plus en plus porté par les clients sur le travail professionnel (perte de confiance, demande de davantage d’écoute et de prise en compte de leurs points de vue). En second lieu, les travailleurs sociaux subissent également une pression à la rentabilité et à l’efficacité économique, et ce, surtout dans les grands services sociaux et organisations sociales tels que, en Belgique, les centres publics d’action sociale des grandes villes. Le management public y a pleinement fait son apparition. Enfin, en troisième lieu, l’européanisation et surtout la création d’un grand marché européen ne sont pas sans effets sur les politiques sociales, même si ces dernières demeurent largement d’inspiration nationale (Barbier, 2008, 2010). Un peu partout en Europe, le travail social est en première ligne d’une quête généralisée d’activation des politiques sociales et de mise en mouvement des allocations, des dispositifs, des professionnels et des usagers. Ainsi que le montre Robert Castel, l’histoire du travail social rejoint bien celle de l’État social et des mouvements inhérents aux politiques sociales. Elles sont étroitement imbriquées l’une à l’autre[6].»
Nathalie Cobbaut
[1] https://www.sciensano.be/fr/biblio/power-care-lenquete-sur-le-bien-etre-des-personnes-et-professionnels-daide-et-de-soin-principaux-0
[3] Marine Keresztes, «Le bien-être au travail. Ré-engager les salariés», CPCP, analyse n°380, 2019, téléchargeable sur le site: http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/09/bien-être-travail.pdf.
[4] Laurent Lorthioir, «Risques psychosociaux au travail: une meilleure législation s’impose!», 3 juin 2021, téléchargeable sur le site de Démocratie: https://bit.ly/3FfvLiT
[5] Paula Franklin et Anne Gkiouleka, «A scoping review of psychological risks to health workers during the Covid-19 pandemic», Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(5), 2453, téléchargeable sur le site: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/5/2453
[6] Didier Vrancken, «Le travail social serait-il devenu une profession?», Pensée Plurielle 2012/2-3, n°30-31.
Des usagers également en souffrance

Si les travailleurs sociaux éprouvent de la souffrance psychosociale dans le cadre de leur activité professionnelle, ils ne sont pas les seuls à trinquer (sans mauvais jeu de mots). La précarité a elle aussi des effets néfastes sur les usagers. Parfois aussi les politiques sociales ne sont pas forcément bienveillantes et provoquent des souffrances dans le chef de ceux et celles qui cherchent de l’aide.
De l’avis des travailleurs sociaux (TS) de terrain, ces derniers rencontreraient de manière de plus en plus fréquente dans le cadre de leur travail des personnes ayant des problèmes de santé mentale au sens large. Anxiété, dépressions, addictions, malades psychiatriques plus graves: problèmes de santé mentale et précarité font malheureusement bon ménage. Un constat qui ressort également des appels téléphoniques passés au numéro vert d’urgence sociale bruxellois ou au 1718, côté wallon.
Les professionnels travaillant dans le milieu psychiatrique rapportent également des cas de souffrances psychiques d’origine sociale. Cette réalité témoigne d’une intense souffrance psychique liée à des conditions matérielles et sociales d’existence qui se dégradent et qui mènent à des troubles anxieux, dépressifs ou encore des comportements addictifs[1]. Le terme de précarité est donc choisi, car il rend compte d’une dimension extrêmement agissante et puissante: celle de la peur. Comme le rapporte Marine Goethaels dans son analyse «Précarité économique et santé mentale», selon le psychiatre Jean Frutos, la précarité, c’est avoir peur: peur de perdre son emploi, ses biens, son logement, son statut social, etc. Jean Frutos parle des «‘objets sociaux’ qui désignent l’ensemble des paramètres qui offrent une sécurité de base et dont la perte annonce la précarité»[2].
Un cercle peu vertueux
Dans un «État des lieux de l’accès aux soins de santé mentale au départ des CPAS bruxellois», Cécile Vanden Bossches’interroge, elle, sur la question de la poule ou de l’œuf: «La précarité touche différents pans de la vie de tous les jours: sphère sociale, médicale, univers professionnel, loisirs, vie active, etc. […] Pour la majorité des CPAS, [précarité et santé mentale] sont liées. Pour certains travailleurs, une dimension prime: la précarité provoque des problèmes de santé mentale. Pour d’autres travailleurs, les difficultés de santé mentale constituent des facteurs générant ou aggravant la précarité. La question de savoir si une dimension entraîne l’autre est complexe.»
Dans cette étude, l’auteure met en avant au travers d’une série de témoignages l’augmentation des problématiques lourdes et le fait que le cumul de ces problématiques rend la prise en charge encore plus complexe pour les TS. «L’ensemble des CPAS souligne une détresse multifactorielle dont la cause principale est d’ordre socioéconomique: les travailleurs font part de difficultés vécues par des usagers qui perdent pied face à leur situation sociale précaire, la lenteur des réponses apportées à leur situation et un contexte qui n’offre pas de solutions permettant d’améliorer le quotidien.» Dès lors, les manifestations psychologiques, voire psychiatriques du mal-être social s’invitent de plus en plus dans le travail social.
De la souffrance ajoutée à la souffrance
Autre source de pression, comme source d’aggravation des souffrances psychosociales déjà existantes: le fait de soumettre les usagers à des exigences parfois démesurées par rapport à leurs possibilités. En cause: la transformation de l’aide sociale à travers les politiques d’activation, qui peuvent mener dans certains cas à des situations d’exclusion. En effet le contrôle du respect des obligations liées à cette activation peut mener dans certains cas à la suppression des droits.
Dans un dossier «Santé mentale et exclusion sociale: à la folie, pas du tout!» paru dans Alter Échos (n°478, octobre 2019), une assistante sociale témoigne anonymement et tient des propos très forts: «On ne prend pas les personnes en charge, on les enfonce. On entretient et on provoque la pauvreté. On déstructure les gens et on les fait décompenser.» Ce qui peut expliquer en partie (mais pas uniquement) l’augmentation de l’agressivité lors des permanences sociales ou encore dans le cadre des entretiens, mais qui est constatée par les travailleurs de terrain.
Quelle prise en charge?
Autre constat face à ces problèmes de santé mentale rencontrés par les usagers: celui de la difficulté de prendre en charge les personnes qui présentent des tels troubles et qui, selon les travailleurs sociaux, ont augmenté depuis une dizaine d’années. Avec la nécessité de prendre conscience des difficultés traversées par les usagers. Toujours dans l’article d’Alter Échos, une travailleuse psychosociale, également sous couvert d’anonymat, explique: «Face à une personne qui délire ou en proie à des hallucinations, il y a chez mes collègues assistants sociaux des réactions du type: ‘Il se fout de ma gueule’, ‘Madame ne veut pas répondre à mes questions’, ‘Il fait l’imbécile dans mon bureau’.» D’où la nécessité de se former pour mieux comprendre les réactions et avoir une attitude la plus adéquate possible.
Une difficulté importante est également liée à la question de l’orientation à donner à ces dossiers, dans lesquelles la personne est en souffrance, de savoir qui appeler, vers qui se tourner. Car, dans certains cas, des relais doivent être faits et une prise en charge psychothérapeutique peut être nécessaire. Les TS se disent dépassés et non formés à ces réalités, ce qui peut mener à une certaine violence institutionnelle ou en tout cas à de l’incompréhension mutuelle. Les TS pensent qu’on les floue, que les délais, les horaires ne sont pas respectés délibérément; de leur côté les usagers ne se sentent pas accueillis, entendus.
Des pistes de solution
Certains CPAS ou centres de référence mettent en place des dispositifs pour prendre en charge ces situations, en engageant des psychologues ou en collaborant avec un service de santé mentale. C’est le cas du GAS qui a son propre service de médiation de dettes, mais également un centre de référence pour la province de Luxembourg. Comme l’explique Catherine Knott, psychologue au GAS, «on se rend bien compte que c’est lourd tant pour les bénéficiaires que pour les médiateurs de dettes, et donc, pour alléger un peu leur fardeau, on leur propose des aides spécifiques. Pour les médiateurs de dettes, c’est du soutien individualisé quand un dossier est difficile à assumer, pour apporter un autre regard et des outils pour débloquer la situation. Il faut savoir gérer la situation quand il y a des tensions, de la colère chez les usagers. Les médiateurs attendent aussi de la collaboration, qui n’est pas toujours facile à établir. Il y a aussi des supervisions collectives où l’on se retrouve avec plusieurs médiateurs autour de cas, ce qui permet de sortir de l’isolement et de voir comment les autres fonctionnent.
Côté usagers, on propose également des entretiens individuels par le biais des médiateurs de dettes, mais aussi des groupes de parole où les personnes suivies peuvent échanger, sortir de leur isolement, dépasser le sentiment de honte, de repli sur soi et se rendre compte qu’ils ne sont pas les seuls à vivre de telles difficultés. L’échange d’expériences est mis en avant dans ces groupes, car les conseils donnés par les pairs sont parfois mieux acceptés que ceux donnés par les professionnels. En tout cas, peut-être grâce au Covid qui a délié les langues sur la santé mentale, c’est que l’étiquette ‘Je ne veux pas aller chez le psy, je ne suis pas fou’ commence à se décoller, ce qui est une bonne chose».
Mais le manque d’outils et de ressources reste très prégnant, tout comme le manque de connaissances sur ces questions de santé mentale au sens large, tout comme le fait de ne pas avoir le temps de se tenir au courant. L’existence des délais d’attente importants dus au manque de places dans les structures de soins et/ou au manque de soignants disponibles est aussi un problème, quand des solutions sont recherchées pour améliorer le bien-être des usagers avant d’entamer un travail social. Des formations existent pour tenter d’outiller les TS à réagir face à toutes ces questions (voir article pages suivantes). Autre piste: le recours à des experts du vécu et à des pairs-aidants, bien au courant des difficultés spécifiques des usagers et permettant de dépasser les difficultés de communication et de prise en charge.
N. Cobbaut
[1] Voir l’analyse d’Eva Cottin, «Liens entre précarité et souffrance psychique», Publication des Femmes prévoyantes socialistes, 2021.
[2] Analyse CPCP, juin 2020, www.cpcp.be/publications/economique-sante-mentale.