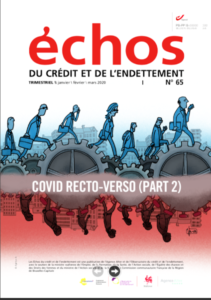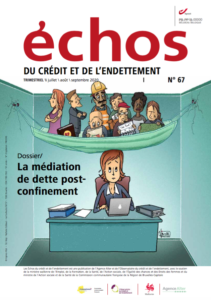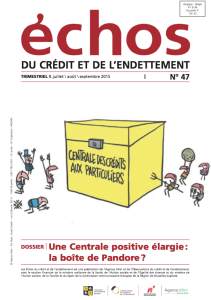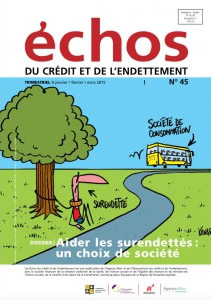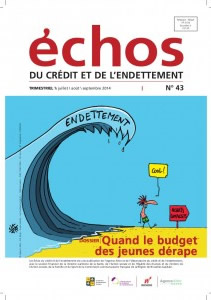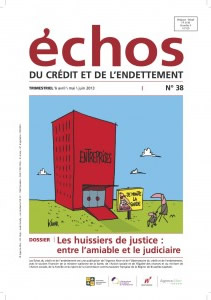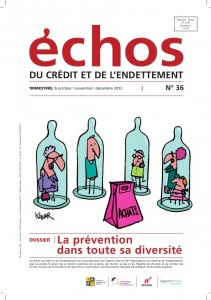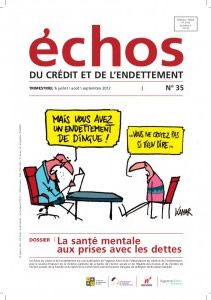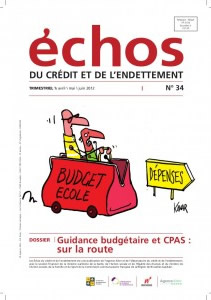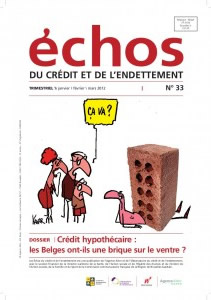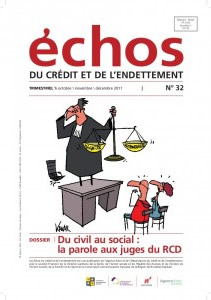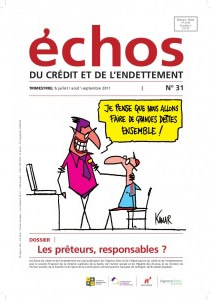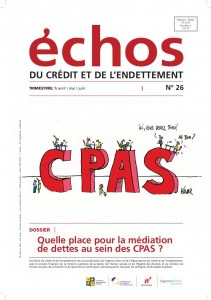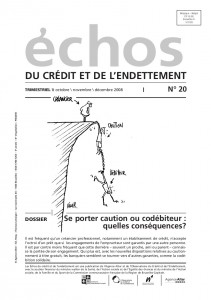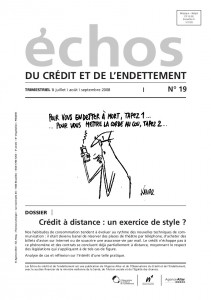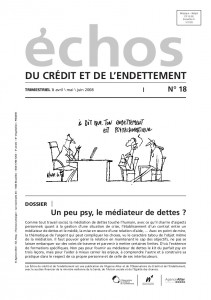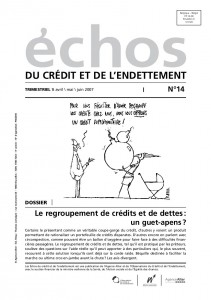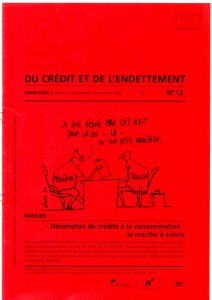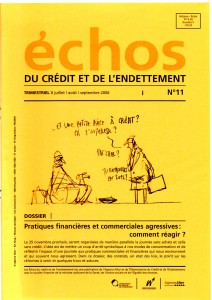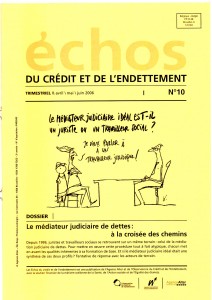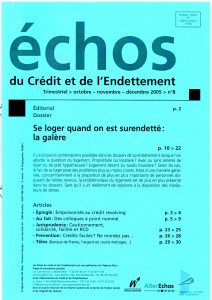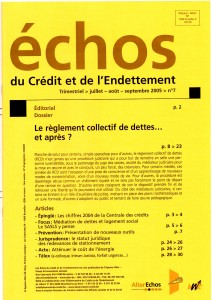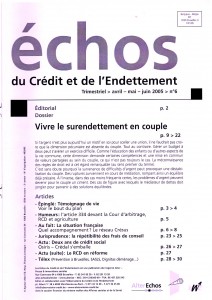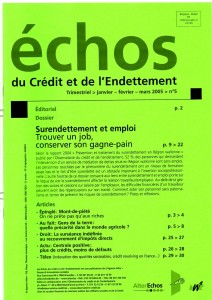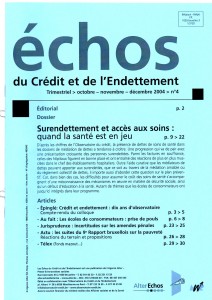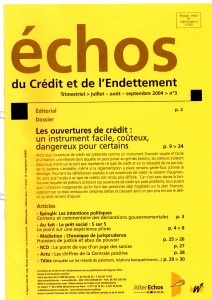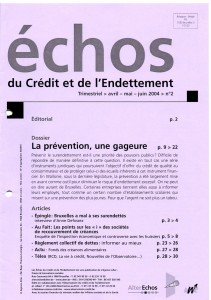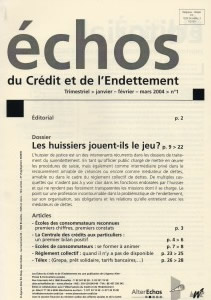Alors que Léa, 17 ans, prépare son bac Section économique et sociale, révisant les concepts de la nouvelle économie, ses parents, ouvriers, sont tous deux virés de leur usine, ou en passe de l’être, pour cause de délocalisation de leur outil de travail. S’ensuivent le chaos financier, le surendettement, les huissiers, mais aussi la révolte, comme dernier désespoir. Le verbe du romancier Pascal Manoukian est acerbe, tout comme le bilan humain. Sur fond de paradoxe d’Anderson.
Le roman débute dans une atmosphère cosy, feutrée. Une famille installée dans le département français de l’Oise, un couple, deux enfants. L’aînée prépare son bac, le cadet vit dans sa bulle. Les parents ne chôment pas (… encore). Ils travaillent tous deux en usine; elle dans une tricoterie qui fabrique des chaussettes, lui comme contremaître chez Univerre, une manufacture de bouteilles. Ils ont construit leur bonheur, et la famille, leur maison représentent à leurs yeux un havre de paix. Très vite pourtant, dès l’entame du roman, on perçoit la menace: juste de l’autre côté de la rue, la maison d’en face, vide depuis un an à la suite de la débâcle financière des voisins, Élise et Jérôme. Licenciement, saisie, vente publique de la maison: «Une vie entière vendue à perte. Un détroussage organisé en toute légalité par les banques et l’État pour se rembourser.»Le ton est donné.
La banqueroute semble contagieuse, quand le tour d’Aline et Christophe vient: les machines à tricoter de l’usine d’Aline, les plus performantes, ont été démontées de nuit et envoyées vers l’Afrique. «Cancer du chômage. Elle [Aline] fait partie des métastasés.»Idem pour Christophe, dont l’usine part en grève à la suite de rumeurs de délocalisation, et le conflit s’enlise.
«– Il paraît qu’on est vendus.
- Univerre?
- Oui, tout le groupe.
Christophe s’insurge:
– Mais ils ont publié les résultats le mois dernier, on fait des bénéfices!
– Ce n’est pas le problème. Les Américains veulent passer à autre chose. […]
– Mais merde! Fallait y penser avant! On a encore vingt-cinq ans à tirer, nous, et presque autant de crédit.»
Alors que le surendettement les guette, le couple décide de cacher la situation aux enfants pour ne pas les inquiéter. Mais les banquiers s’ébrouent, MeGaston, l’huissier de la région, frappe déjà à la porte… La révolte n’est pas loin, l’incivisme comme réponse au désespoir non plus.
Pendant ce temps, Léa revise le bac et étudie le chapitre sur la «Quatrième révolution industrielle, l’intelligence artificielle»: elle y apprend que l’innovation invente perpétuellement de nouveaux emplois qui en détruisent d’autres. On appelle cela «la destruction créatrice». Seulement cela se passe généralement avec une marge d’erreur, une «casse marginale». «Ainsi chaque révolution se faisait au prix du sacrifice d’un quota de travailleurs inadaptés.»Autre notion au programme: celle du paradoxe d’Anderson, selon lequel «l’acquisition par un étudiant d’un diplôme supérieur à celui de ses parents ne lui assure pas forcément une position supérieure dans la vie professionnelle».Tous ne seront pas élus… Et le risque est non négligeable.
Le paradoxe d’Andersonest le troisième roman de Pascal Manoukian, journaliste grand reporter de guerre. Dans ses premiers romans, il a abordé des sujets graves comme les grands conflits mondiaux, le génocide arménien, l’univers des migrants ou la montée des extrémismes. Son dernier opus traite d’un monde ouvrier secoué par les soubresauts d’une économie qui se meurt. Sa plume est trempée dans l’encre de l’indignation face à un monde qui se dualise et qui fait payer très cher à toute une catégorie de population le prix du changement, alors que d’autres s’enrichissent.«Chacun tremble de devoir renoncer à sa manière de vivre, d’être obligé de sacrifier la scolarité d’un enfant sur deux, de ne plus pouvoir s’occuper dignement de ses parents. La marée monte, inexorablement, inondant les classes moyennes.»Avec la truculence littéraire d’un John Irving, Pascal Manoukian s’insurge par roman interposé et ça fait du bien.
N. Cobbaut