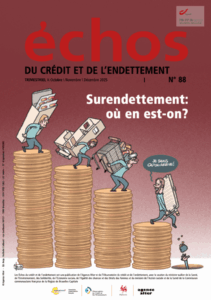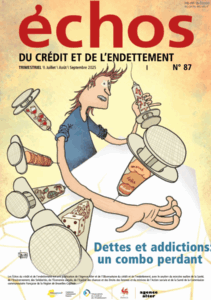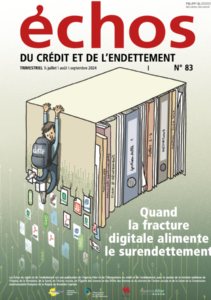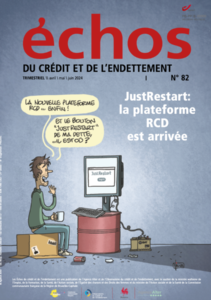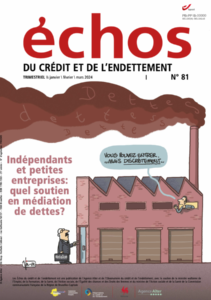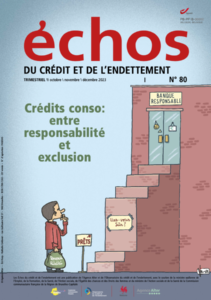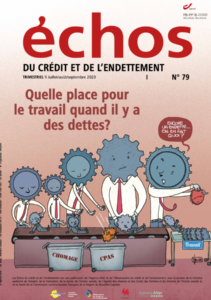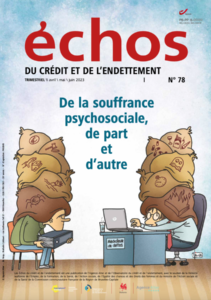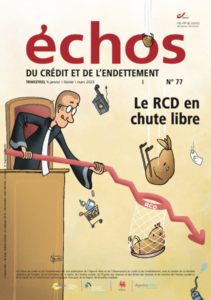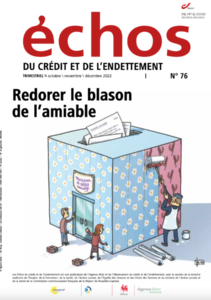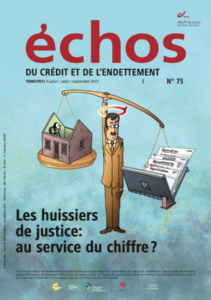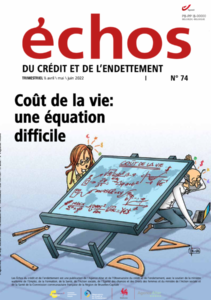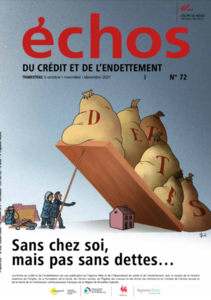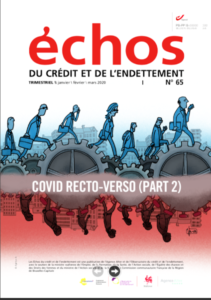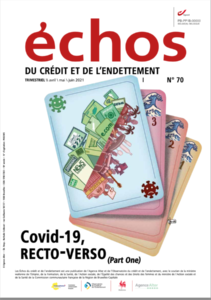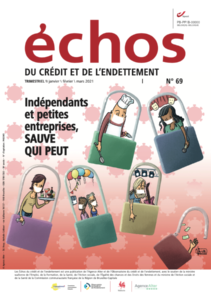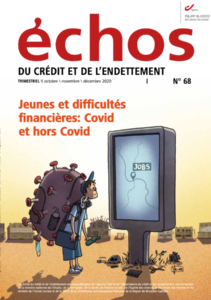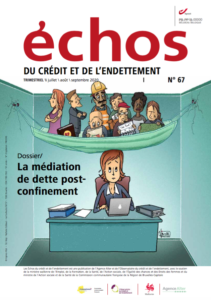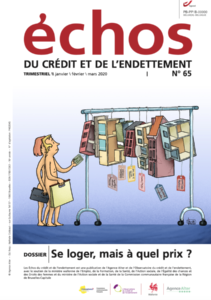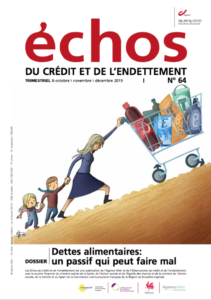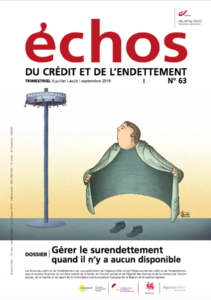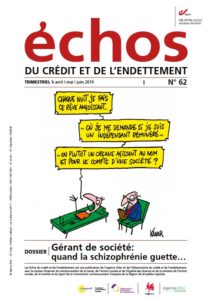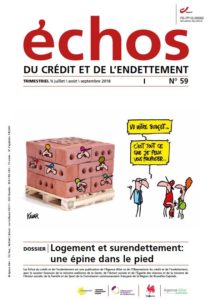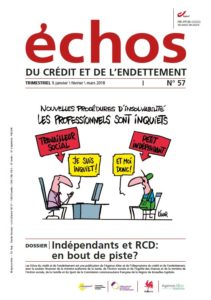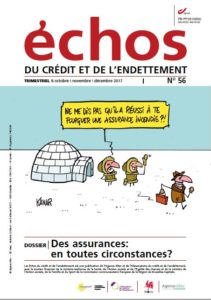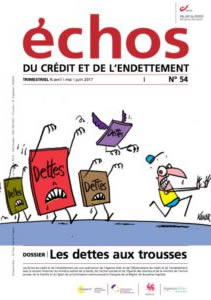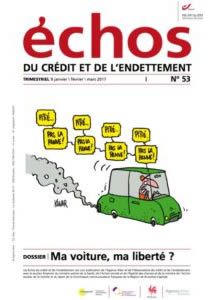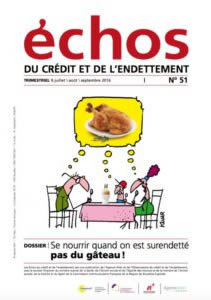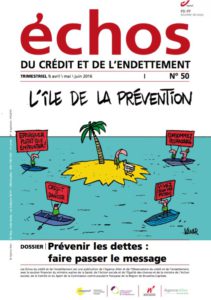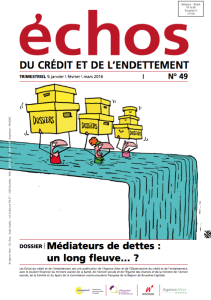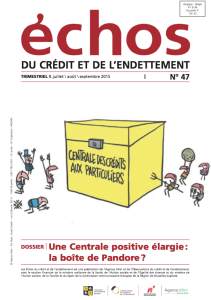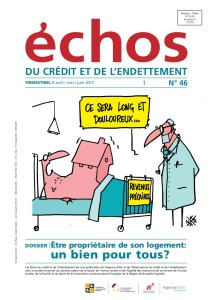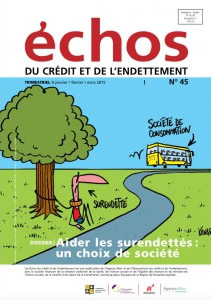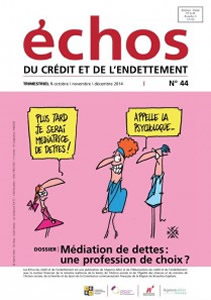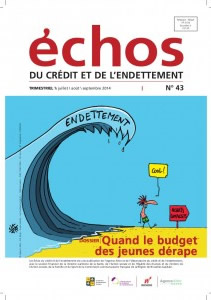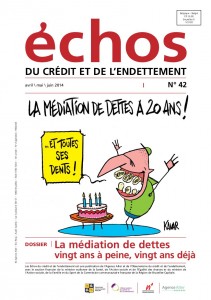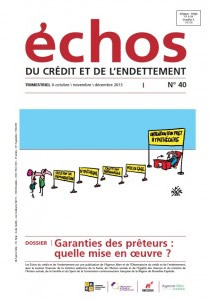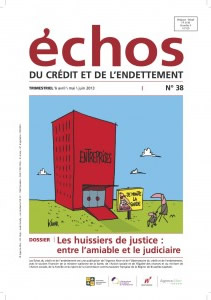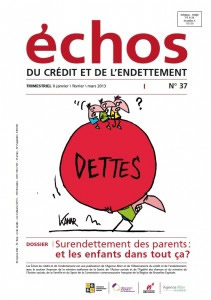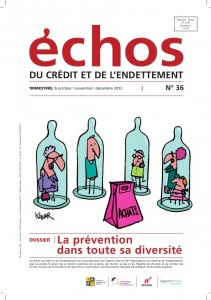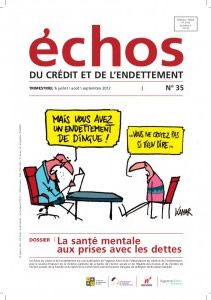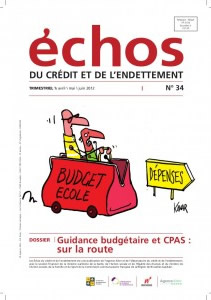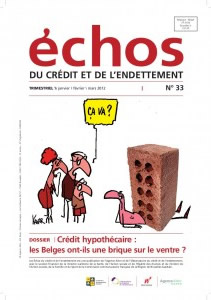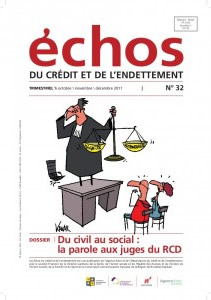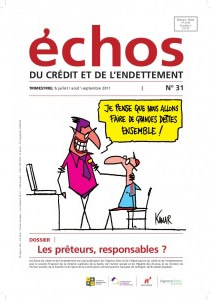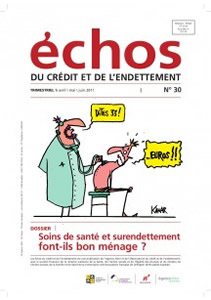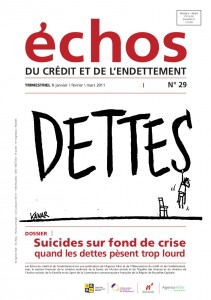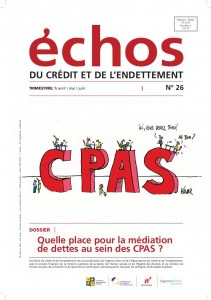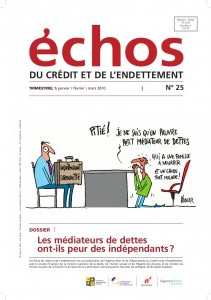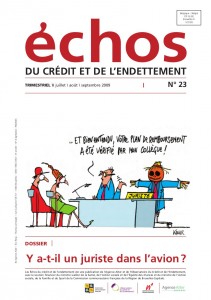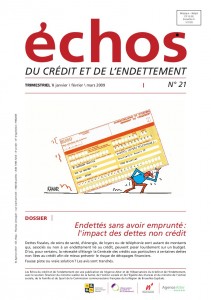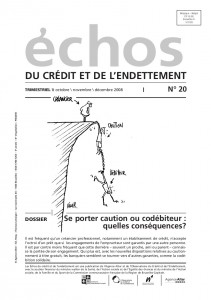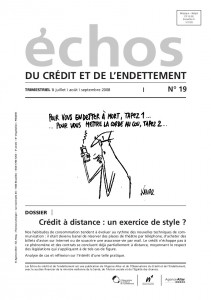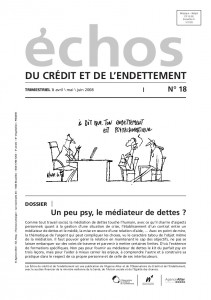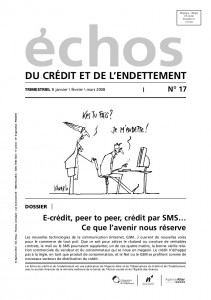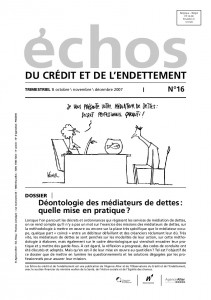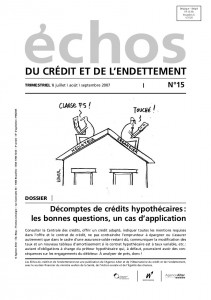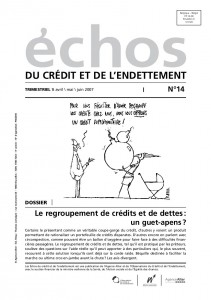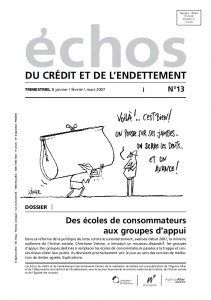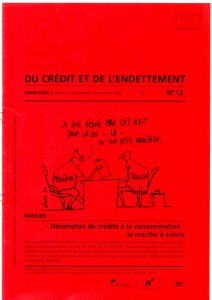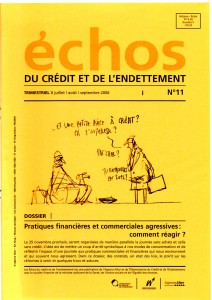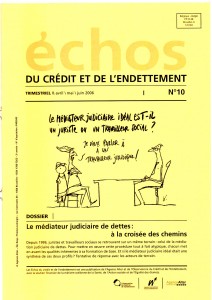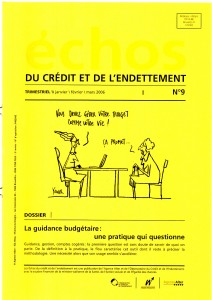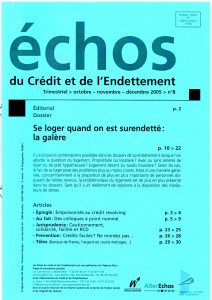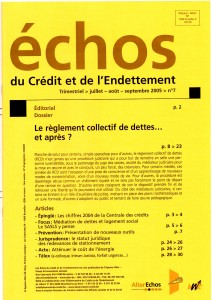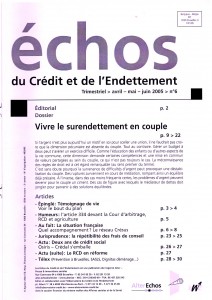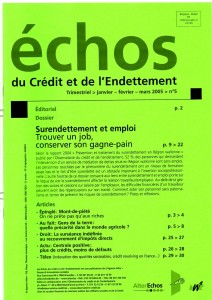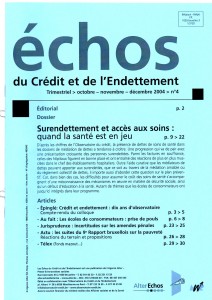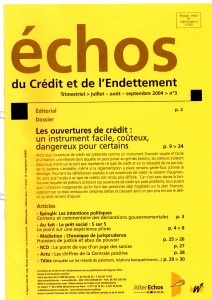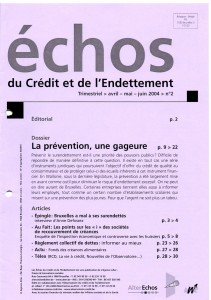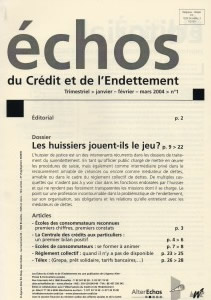Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes. En voici la recension.
Cour de cassation (3e ch.), 17 février 2025 (S.22.0045.N)
Demande de révocation – Médiateur de dettes – Irrecevabilité de l’appel – Intérêt à l’appel – Qualité de partie en première instance – Oui
Conformément à l’article 1675/15, §1 du Code judiciaire, le médiateur de dettes, demandeur en cassation, a sollicité la révocation de la décision d’admissibilité en règlement collectif de dettes accordée au débiteur, défendeur en cassation.
En première instance, la demande de révocation a été déclarée recevable mais non fondée. Le médiateur de dettes interjette appel de cette décision.
Le 11 avril 2022, la cour du travail de Gand déclare l’appel irrecevable sur la base de l’article 17 du Code judiciaire selon lequel «l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former». Autrement dit, «un appel ne peut être interjeté que par une personne qui était partie à la procédure de première instance, en tant que demandeur, défendeur ou partie intervenante, et dont les intérêts ont été lésés par la décision attaquée»[1]. Ainsi, la cour du travail considère que le médiateur n’a pas la qualité requise, car il ne peut pas être considéré comme partie à la procédure de demande de révocation. La cour du travail rappelle que le médiateur est indépendant et impartial, il ne représente ni le débiteur ni les créanciers, de sorte qu’il ne peut être considéré comme lésé par une décision rejetant sa demande de révocation et ne dispose donc pas de l’intérêt requis pour interjeter appel.
Un pourvoi en cassation est donc introduit par le médiateur de dettes.
Concernant la qualité requise, la Cour de cassation considère que lorsque le médiateur introduit une demande de révocation, «il agit en tant que partie à la procédure qui statue sur la révocation»[2].
Concernant l’intérêt à former le recours, la Cour de cassation considère que lorsque le médiateur introduit une demande de révocation, «si sa demande de révocation est rejetée, il a un intérêt à la réforme ou à l’annulation de cette décision en appel»[3].
Ainsi, la Cour casse le jugement de la cour d’appel attaqué.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 9e chambre, 20 mars 2025 (RG 2024/00082/B)
Demande de révocation – Manque de collaboration – Versements hors compte de médiation – Aggravation fautive du passif – Amendes pénales – Fait générateur – Commission de l’infraction – Antériorité à la décision d’admissibilité – Oui – Dette de la masse – Aggravation fautive du passif – Non
Le débiteur est admis à la procédure en règlement collectif de dettes par une ordonnance du 24 mai 2024.
Le 21 janvier 2025, le médiateur dépose une requête en fixation du dossier pour difficultés sur la base de l’article 1675/14, §2 du Code judiciaire et, à titre subsidiaire, pour révocation sur la base de l’article 1675/15 du Code judiciaire ou rejet de la procédure. Parmi les créanciers, seule l’ex-compagne du débiteur est présente à l’audience.
L’article 1675/15, §1 liste les manquements du débiteur à la suite desquels une révocation peut être demandée. Cependant, le tribunal rappelle le principe selon lequel la révocation n’est pas automatiquement prononcée. Elle nécessite une appréciation souveraine par le juge du caractère suffisamment grave du manquement, notamment eu égard «au fait que le débiteur a modifié son comportement», à l’importance et au caractère inexcusable des manquements.
La notion de bonne foi procédurale peut également être utilisée dans l’appréciation du juge. Cette bonne foi procédurale implique pour le débiteur, «d’une part, une transparence totale concernant sa situation dans sa globalité et, d’autre part, une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure en règlement collectif de dettes». Il est tout de même rappelé que «l’absence de bonne foi procédurale ne peut justifier à elle seule la révocation». Un manquement de la liste de l’article 1675/15, §1 du Code judiciaire reste à démontrer.
Premièrement, le médiateur avance un manque de collaboration du débiteur dans le cadre de sa gestion budgétaire. Ce dernier a demandé la fin d’une gestion budgétaire entamée auprès du service social du CPAS antérieurement à l’admissibilité au règlement collectif de dettes. Il a donc pu percevoir directement son pécule de médiation sur son nouveau compte retrait, mais le dépense intégralement dans la première quinzaine du mois et sollicite des demandes d’aide sociale en urgence.
Le tribunal considère, eu égard au caractère volontaire de la gestion budgétaire, que cette décision d’y mettre fin «ne constitue pas un motif suffisant de révocation».
Deuxièmement, le médiateur fait état de versements faits par de tierces personnes en faveur du débiteur sur son compte retrait, sans être transmis sur le compte de médiation. Ces versements varient entre 500 et 600 €. Le débiteur explique ces derniers par des remboursements de prêts faits à des tiers.
Le tribunal rappelle que «tout paiement fait en faveur du médié doit en principe avoir lieu sur le compte de médiation», conformément à l’article 1675/9, §1, 4° du Code judiciaire. Si le versement de 600 € «interpelle davantage», le tribunal considère, eu égard aux petites sommes dont il est question, que l’explication du débiteur n’est «pas dépourvue de toute crédibilité». Le tribunal se limite «à ce stade» à un rappel de l’obligation de reversement des sommes sur le compte de médiation, sans y voir un motif suffisant de révocation.
Troisièmement, le médiateur souligne une aggravation fautive du passif suite à plusieurs condamnations judiciaires. La première concerne un jugement du 28 mai 2024 condamnant le débiteur à une indemnisation pour préjudice corporel à son ex-compagne d’un montant de 9.431,77 €. Deux autres décisions judiciaires du 5 décembre 2023 et du 7 février 2024 condamnent le médié à 5.520,49 € d’amendes pénales. Ces dettes sont considérées comme incompressibles.
Pour constituer une aggravation fautive du passif au sens de l’article 1675/15, §1, alinéa 1, 3° du Code judiciaire, les faits générateurs doivent être postérieurs à l’ordonnance d’admissibilité en règlement collectif de dettes. S’agissant des trois dettes précitées, il est donc à déterminer si leur fait générateur est antérieur ou postérieur au 24 mai 2024, date de l’admissibilité du débiteur. Pour ce faire se pose la question de savoir si ces dettes sont «nées au moment de la commission des faits infractionnels qui ont ensuite entraîné une condamnation, ou au moment du prononcé de cette condamnation par une juridiction». Le tribunal s’en réfère à la doctrine et à la jurisprudence qui considèrent que le fait générateur d’une amende pénale se situe au moment de la commission de l’infraction et non au moment de la prononciation du jugement.
Or, en l’espèce, les faits générateurs de ces condamnations sont tous antérieurs à l’ordonnance d’admissibilité en règlement collectif de dettes. Par conséquent, ces dettes doivent être considérées comme faisant partie de la masse passive et ne constituent pas une aggravation fautive du passif.
En outre, selon le médiateur, le débiteur risque de perdre son droit aux indemnités de mutuelle s’il est incarcéré en raison de la révocation de son sursis probatoire. Le tribunal souligne qu’une mesure de surveillance électronique a été mise en place à la suite de la révocation du sursis probatoire, ce qui n’impacte pas le droit du médié aux indemnités de mutuelle.
En conclusion, quant à la demande de révocation/rejet, le tribunal considère «qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de motifs suffisants pour justifier une révocation ou un rejet de la procédure» et déclare donc la demande non fondée.
Enfin, suite à la demande de remplacement de médiateur formée par le médié sur la base de l’article 1675/15, §4 du Code judiciaire, le tribunal convoque le médiateur en chambre du conseil pour l’entendre sur cette question.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Cour du travail de Bruxelles, 11e chambre, 3 mars 2025 (RG 2024/AB/705)
Registre central de règlement collectif de dettes – Support papier – Non avenues – Sanction de nullité – Atteinte aux intérêts
Monsieur et Madame ont été admis en règlement collectif de dettes par une ordonnance du 12 novembre 2015. En octobre 2017, un plan de règlement amiable est homologué. Ce règlement est suspendu en vue de son réexamen en décembre 2021. Monsieur est révoqué le 31 mai 2023. Le 27 juin 2024, le médiateur dépose une requête pour difficultés ou faits nouveaux, en vue de l’homologation d’un plan amiable révisé. Par jugement du 11 octobre 2024, le plan de règlement amiable révisé déposé le 27 juin est homologué.
Madame interjette appel de ce jugement le 28 octobre 2024. Elle demande que tous les actes de procédure accomplis en méconnaissance de l’article 1675/15bis, §1 du Code judiciaire relatif au registre central de règlement collectif de dettes, surnommé JustRestart, soient déclarés nuls de plein droit. Et par conséquent, Madame sollicite la nullité du jugement du 11 octobre 2024 et l’écartement de la procédure des créanciers-personnes morales belges.
Le 21 novembre 2021, le médiateur forme un appel incident reprenant les mêmes motifs, sollicitant notamment que les «actes affectés par la sanction de l’article 1675/15bis du Code judiciaire soient écartés du dossier»[4] et que le jugement soit annulé.
La cour du travail de Bruxelles juge l’appel et l’appel incident recevables après avoir vérifié le respect de l’article 1675/15bis, §1 conditionnant la recevabilité des recours à leur dépôt via JustRestart.
Dans ses conclusions, le médiateur souligne que les notifications envoyées par le greffe du tribunal du travail à Madame, au médiateur lui-même ainsi qu’aux créanciers-personnes morales belges n’ont pas été faites par l’intermédiaire de JustRestart comme prévu par l’article 1675/15bis, §1er, alinéa 1 et 2 du Code judiciaire. Il est donc sollicité que celles-ci soient considérées comme non avenues.
Le médiateur et Madame soulignent tous deux que deux autres actes n’ont pas été effectués au moyen de JustRestart: il s’agit du projet de plan de règlement amiable envoyé aux créanciers et à la médiée par le médiateur ainsi que de la convocation à l’audience du 13 septembre 2024 devant le tribunal du travail.
La Cour rappelle le contenu de l’article 1675/15bis du Code judiciaire avant de citer l’article 1675/16 du Code judiciaire fixant la forme que doivent prendre les actes non effectués par l’intermédiaire de JustRestart. La Cour souligne qu’«un support papier n’est autorisé que lorsque la loi le prévoit»[5].
La Cour rappelle ensuite l’article 860 du Code judiciaire selon lequel, «quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul […] si la sanction n’est pas formellement prononcée par la loi». La notion d’acte de procédure telle que définie par la Cour de cassation comprend bien les actions du médiateur et du greffe.
Le texte de l’article 1675/15bis, §1, alinéa 3, ne prévoit pas formellement une sanction de nullité; il énonce uniquement que «toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non avenu». La Cour considère cependant que «la condition selon laquelle la loi doit avoir expressément ordonné la sanction de la nullité ne doit pas être interprétée littéralement»[6], la qualification expresse de nullité n’est donc pas requise. Ainsi, selon la Cour, la sanction de l’article 1675/15bis, §1, 3e alinéa «doit être interprétée comme une sanction de nullité au sens de l’article 860 du Code judiciaire»[7].
Après avoir confirmé cette interprétation selon laquelle la sanction de l’article 1675/15bis est bien une sanction de nullité, la Cour se penche ensuite sur l’article 861 du Code judiciaire, selon lequel «le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure […] que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception».
En ce qui concerne le projet de plan de règlement amiable envoyé par le médiateur par lettre recommandée aux créanciers et à Madame, ces derniers ont chacun expressément accepté le projet de plan. La cour considère donc que ni Madame ni le médiateur, ayant lui-même commis l’irrégularité, ne démontrent que celle-ci a porté atteinte à leurs intérêts.
En ce qui concerne la convocation devant le tribunal du travail par voie papier, la Cour considère également que «ni Madame ni le médiateur de dettes ne démontrent que l’irrégularité dont ils se plaignent a porté préjudice à leurs intérêts»[8].
La Cour se prononce de la même manière en ce qui concerne les notifications envoyées par le greffe du tribunal du travail à Madame, au médiateur et aux créanciers-personnes morales belges.
Considérant ce qui précède, la Cour considère que «le premier juge a eu raison d’homologuer l’accord amiable après révision du 15 mars 2024, adressé par lettre recommandée aux créanciers le 15 mars 2024, tel que déposé par le médiateur de dettes le 27 juin 2024»[9]. L’appel et l’appel incident sont donc déclarés non fondés et le jugement du 11 octobre 2024 est confirmé.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, 5e chambre, 10 avril 2025 (RG 19/172.B)
Compensation fiscale – Imputation des paiements – Déclaration tardive de nouvelle créance – Fait générateur de la dette – Répartition du solde du compte de médiation
Le 10 avril 2019, Monsieur a été admis en règlement collectif de dettes. Dans ce cadre, un plan amiable a été homologué en octobre 2021. Ce plan prévoyait une durée de cinq ans à dater du 10 avril 2019, avec remise des frais et intérêts au terme du plan.
Le terme du plan est donc atteint depuis le 9 avril 2024. Dans son jugement de clôture, le tribunal s’est vu saisi de deux difficultés signalées par le médiateur.
Premièrement, une mauvaise imputation des paiements complique la détermination du montant de la créance en principal restant due au SPF Finances et, par conséquent, la répartition au marc l’euro du solde du compte de médiation aux créanciers.
Certaines des imputations effectuées par le SPF Finances ont été effectuées sur des remboursements d’impôts. Le tribunal fait donc état, dans un premier temps, de la législation et de la jurisprudence en matière de compensation fiscale[10]. S’agissant d’un règlement collectif de dettes reposant sur un plan de règlement amiable, le tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation[11], laquelle précise qu’en l’absence de «disposition expresse au sujet de la possibilité d’appliquer la compensation» dans le plan amiable, «il appartient au juge de décider si la compensation fiscale peut avoir lieu et dans quelle mesure». Tel est le cas ici.
Le tribunal se penche ensuite sur la question de la mauvaise imputation des paiements. Il s’avère que le SPF Finances a effectué des imputations en priorité sur les frais et accessoires de sa créance. Le tribunal rappelle sur ce point la règle légale selon laquelle les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales s’imputent d’abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives, et enfin sur la créance en principal restant due[12]. Cependant, en l’espèce, ces imputations ont été effectuées en contradiction avec les modalités du plan amiable prévoyant une remise des intérêts et frais au terme du plan.
Selon le tribunal, cette pratique nuit à la répartition au marc l’euro entre les créanciers pour laquelle seul le solde de l’endettement en principal est à considérer. Il souligne par ailleurs que la compensation fiscale ne peut permettre «d’obtenir de manière détournée le paiement d’intérêts et frais alors que les autres créanciers renoncent aux accessoires de leurs créances».
Le tribunal corrige donc le solde restant dû au SPF Finances en imputant les montants payés sur le principal.
Deuxièmement, la caisse d’assurance sociale (reprise comme créancier non déclarant dans l’ordonnance d’homologation du plan amiable) a déposé une nouvelle déclaration de créance le 6 septembre 2024 (soit après le terme du plan) concernant des «cotisations de sécurité sociale enrôlées suite à une rectification des revenus 2017 effectuée par le SPF Finances».
Le tribunal rappelle notamment les conditions à respecter pour intégrer une nouvelle créance au passif admis au plan: «D’une part, la créance doit être antérieure à l’ordonnance d’admissibilité. D’autre part, il ne doit pas s’agir d’une déclaration de créance complémentaire faite par un créancier déjà admis au plan et qui a omis une autre créance.» Concernant la première condition, le tribunal considère, malgré une doctrine partagée, que la détermination des dettes existantes au jour de l’admissibilité repose sur le critère du fait générateur et non de l’exigibilité, comme le suggèrent les travaux préparatoires.
Ainsi, la créance de la caisse d’assurance sociale ayant pour origine une rectification par le SPF Finances de l’imposition des revenus d’indépendant promérités en 2017, le tribunal considère que cette créance peut être intégrée au plan amiable, sans effet rétroactif[13]. Il est souligné que la caisse d’assurance sociale n’aurait pu déposer cette déclaration de créance antérieurement en ce qu’elle ignorait cette rectification. Le tribunal mentionne par ailleurs l’accord du créancier et du médié sur cette intégration, le plan amiable prévoyant une intégration d’office de toute créance d’un montant inférieur à 25% du passif total «sans nécessité d’adaptation du plan à concurrence du principal».
Le solde du compte de médiation sera donc «réparti entre les créanciers au marc l’euro en tenant compte du solde du principal des dettes admises au plan», en considérant la créance du SPF Finances à concurrence du solde en principal fixé par le tribunal et de la créance de la caisse d’assurance sociale intégrée par le tribunal.
Il est donc dit que la remise des intérêts et accessoires est acquise et qu’il est mis fin à la procédure de règlement collectif de dettes.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Maëlle Servais, juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement
[1] Traduction libre.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
[11] Cass. 8 décembre 2014, S.13.0035/N.
[12] Article 18 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
[13] Sans versement de dividendes de rattrapage.